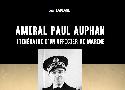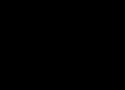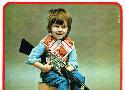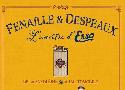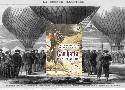4243 shaares
195 résultats
taggé
histoire
« Hiro Onoda, qui a inspiré Onoda - 10 000 nuits dans la jungle, est une figure historique légendaire de ces soldats nippons "perdus" qui ont poursuivi la guerre au-delà de la fin du conflit. Envoyé sur l'île de Lubang aux Philippines avec ordre de combattre jusqu'à ce qu'on vienne le chercher, il va continuer à se battre dans la jungle, d'abord en compagnie de trois autres soldats, puis seul, jusqu'en 1974, soit presque trente ans après la reddition du Japon en 1945. Il ne déposera les armes que sur ordre de son supérieur (entre temps il refusera toute injonction de la police et tuera près de trente paysans sur l'île). Gracié, il publiera ses mémoires dans la foulée en 1974 et sera cité dans divers œuvres culturelles (roman, musique, film). »
« Le cinéaste Arthur Harari, qui désirait faire un film d’aventure, explique (cf. bonus) que c'est son père qui lui a parlé de ce "héros" extraordinaire au patriotisme exacerbé. […] Si le cinéaste s'est documenté sur le personnage et a bénéficié des recherches de Bernard Cendron, il précise ne pas avoir voulu tomber dans la reconstitution historique irréprochable au profit d'une intrigue plus universaliste […] Fascinant par son esthétique et intrigant par son histoire et la richesse de sa thématique, Onoda - 10 000 nuits dans la jungle réussit, sans jamais appliquer les codes du biopic édifiant, à conjuguer la simplicité d'un portrait nuancé et limpide, mais guère chargé d'émotion, et la grandeur de l'Histoire abordée par ce fait inconcevable. Assurément, la mise en scène sophistiquée de Onoda - 10 000 nuits dans la jungle, est bien le signe d'un cinéaste avec qui il faudra compter. »
« Le cinéaste Arthur Harari, qui désirait faire un film d’aventure, explique (cf. bonus) que c'est son père qui lui a parlé de ce "héros" extraordinaire au patriotisme exacerbé. […] Si le cinéaste s'est documenté sur le personnage et a bénéficié des recherches de Bernard Cendron, il précise ne pas avoir voulu tomber dans la reconstitution historique irréprochable au profit d'une intrigue plus universaliste […] Fascinant par son esthétique et intrigant par son histoire et la richesse de sa thématique, Onoda - 10 000 nuits dans la jungle réussit, sans jamais appliquer les codes du biopic édifiant, à conjuguer la simplicité d'un portrait nuancé et limpide, mais guère chargé d'émotion, et la grandeur de l'Histoire abordée par ce fait inconcevable. Assurément, la mise en scène sophistiquée de Onoda - 10 000 nuits dans la jungle, est bien le signe d'un cinéaste avec qui il faudra compter. »
« "Nos démocraties sont soumises à des vents mauvais, à une forme de négation de l'histoire et de ses heures les plus sombres, presque pour effacer notre responsabilité", a-t-elle déploré après une visite du mémorial d'Oradour, où 643 personnes furent massacrées le 10 juin 1944 par la division allemande SS Das Reich. "Si nous ne sommes pas vigilants, si on laisse l'histoire faire son travail d'oubli, d'amnésie, alors tout est possible", a-t-elle alerté face à la presse, estimant que "soit par lâcheté, soit par manque de courage", "tout peut se reproduire". […] "Quand un candidat se permet de dire que le maréchal Pétain et le général de Gaulle c'est la même chose: oui, il y a un vrai risque", a-t-elle abondé plus tard lors d'une conférence de presse, visant directement le candidat putatif d'extrême droite Éric Zemmour. »
Reste que dénoncer des « vents mauvais », a fortiori en pareille circonstance, cela fait forcément écho au discours prononcé en 1941 par le maréchal Pétain : « De plusieurs régions de France, je sens se lever depuis quelques semaines, un vent mauvais. » Anne Hidalgo et son équipe n'étant pas suspects, à nos yeux, d'avoir voulu commettre une provocation, la conclusion s'impose : ce discours de Pétain, pourtant très connu, ils ne l'ont vraisemblablement jamais lu, ni entendu. Et sans doute ne sont-ils pas les seuls à méconnaître l'historie qu'ils instrumentalisent à des fins politiciennes. Si tel n'était pas le cas, à vrai dire, on n'attaquerait pas si volontiers Zemmour sur ce point !
Reste que dénoncer des « vents mauvais », a fortiori en pareille circonstance, cela fait forcément écho au discours prononcé en 1941 par le maréchal Pétain : « De plusieurs régions de France, je sens se lever depuis quelques semaines, un vent mauvais. » Anne Hidalgo et son équipe n'étant pas suspects, à nos yeux, d'avoir voulu commettre une provocation, la conclusion s'impose : ce discours de Pétain, pourtant très connu, ils ne l'ont vraisemblablement jamais lu, ni entendu. Et sans doute ne sont-ils pas les seuls à méconnaître l'historie qu'ils instrumentalisent à des fins politiciennes. Si tel n'était pas le cas, à vrai dire, on n'attaquerait pas si volontiers Zemmour sur ce point !
« On peut évidemment discuter le diagnostic de Zemmour. On peut aussi considérer que, malgré sa main tendue "aux musulmans qui s'assimilent" […], il sous-estime leur diversité et ne voit pas qu'une petite majorité d'entre eux est en bonne voie d'assimilation. […] Du coup, il prend le risque de heurter beaucoup de gens et d'apparaître comme un adversaire non pas de l'islam politique, mais de la religion musulmane. […] Pour autant, est-il raisonnable d'accuser le crypto-candidat de vouloir expulser (voire pire) tous les musulmans ou fermer toutes les mosquées ? […] Ceux qui dénoncent en boucle "le candidat de la peur" n'ont pas grand-chose d'autre à vendre que la peur de Zemmour. »
« Sur la question des prénoms, sa position n'est pas exempte de critiques. Comme souvent, il refuse de partir de la réalité de la société, méconnaissant que l'individualisme a fait son œuvre et que bien peu de Français accepteraient aujourd'hui que l'État se mêle de prénommer leurs gosses. […] Mais on riposte toujours avec la même méthode. Pour commencer, on nie le problème, puisque, c'est bien connu, les petits-enfants d'immigrés s'appellent tous Nicolas. [...] Ensuite, on travestit ses propositions, puis le téléphone arabe fait le reste. De sorte que, bien qu'il ait formellement affirmé le contraire, de nombreux musulmans sont convaincus qu'il les obligerait à changer de prénom. »
« Il faut enfin s'arrêter sur le sujet sensible de "Zemmour et la question juive", qui a donné lieu à sa passe d'armes avec BHL, mais aussi à la scandaleuse intervention du CRIF dont le président a lancé "Pas une voix juive pour Zemmour", comme si le CRIF était le Parti des juifs. »
« Commençons par l'affaire Pétain, si on peut dire. Non, Zemmour ne réhabilite nullement le régime qui a privé son père de nationalité française, il parle même à son sujet d'ignominie morale. Conformément à son habitus, il n'en analyse pas moins très (trop ?) froidement sa politique. Là encore ses accusateurs sautent comme des cabris : "Le salaud, il dit que Pétain a sauvé des juifs !" Mais ils ne se demandent nullement si c'est vrai, la question même serait criminelle. Faute des connaissances suffisantes, je ne saurais le démentir ni l'approuver, mais Gil Mihaely a eu la bonne idée de demander à Stéphane Amar, notre correspondant en Israël, d'interviewer Alain Michel, le rabbin-historien dont Zemmour reprend les thèses. […] Ses propos, qui vont à l'encontre de certitudes inculquées depuis l'adolescence, ne laissent pas de troubler. Mais n'est-ce pas le propre de toute pensée stimulante ? Rappelons ce qu'écrit Raymond Aron en 1979, dans un article intitulé "Les Juifs, Vichy et Israël", où il critique un livre d'Alfred Fabre-Luce : "Fabre-Luce cite une phrase d'un historien non suspect d'antisémitisme, Léon Poliakov : 'Du sort relativement plus clément des juifs de France, Vichy fut en fait le facteur prépondérant.' On peut discuter l'adjectif prépondérant, pas réfuter les chiffres." Peut-être Raymond Aron se trompe-t-il, mais nos belles âmes résistantes d'aujourd'hui auraient-elles le front de l'accuser d'antisémitisme et de pétainisme ? On ne suivra pas Zemmour, même dans son questionnement, quand il fait de Pétain, signataire du statut des Juifs, un chantre de l'assimilation. Mais pousser le bouchon trop loin ne fait pas de lui un criminel contre l'humanité. Et s'il ébranle nos certitudes, c'est peut-être qu'elles sont fautives. »
« On ne saurait cependant passer sous silence le malaise que provoque le cas Zemmour chez nombre de juifs de France qui ne sont plus vraiment des israélites selon son cœur, ce qui ne les empêche pas d'être pleinement français. […] Si beaucoup partagent son inquiétude, et c'est un faible mot, face à l'islamisation qui en a tué certains et fait partir d'autres, en Israël ou vers des zones moins hostiles que leur banlieue, ils n'ont pas envie de voir ressurgir le soupçon de double allégeance ni de renoncer à l'attachement que beaucoup éprouvent pour Israël, refuge éventuel où la plupart n'iront jamais s'installer. Eh bien, dira-t-on, n'est-ce pas la définition même de la double-allégeance ? Sauf que, d'une part, le souci d'Israël n'emporte nullement la haine de la France et que, d'autre part, l'amour de sa patrie doit, comme celui d'un être cher, souffrir l'ambiguïté et même une certaine dose de contradiction. Or, habité par une conception quasi mathématique de la nation et de l'histoire, Zemmour refuse cette zone grise où les choses ne se démontrent pas mais se ressentent. Ce qui explique son incapacité à prendre en compte les tourments des identités minoritaires (et cela s'applique à nombre de juifs aussi bien qu'à beaucoup de musulmans) comme une partie intégrante de la réalité. Cela ne signifie pas que l'on doive accepter toutes les réclamations qui en découlent, mais qu'il faut les comprendre. »
« Sur la question des prénoms, sa position n'est pas exempte de critiques. Comme souvent, il refuse de partir de la réalité de la société, méconnaissant que l'individualisme a fait son œuvre et que bien peu de Français accepteraient aujourd'hui que l'État se mêle de prénommer leurs gosses. […] Mais on riposte toujours avec la même méthode. Pour commencer, on nie le problème, puisque, c'est bien connu, les petits-enfants d'immigrés s'appellent tous Nicolas. [...] Ensuite, on travestit ses propositions, puis le téléphone arabe fait le reste. De sorte que, bien qu'il ait formellement affirmé le contraire, de nombreux musulmans sont convaincus qu'il les obligerait à changer de prénom. »
« Il faut enfin s'arrêter sur le sujet sensible de "Zemmour et la question juive", qui a donné lieu à sa passe d'armes avec BHL, mais aussi à la scandaleuse intervention du CRIF dont le président a lancé "Pas une voix juive pour Zemmour", comme si le CRIF était le Parti des juifs. »
« Commençons par l'affaire Pétain, si on peut dire. Non, Zemmour ne réhabilite nullement le régime qui a privé son père de nationalité française, il parle même à son sujet d'ignominie morale. Conformément à son habitus, il n'en analyse pas moins très (trop ?) froidement sa politique. Là encore ses accusateurs sautent comme des cabris : "Le salaud, il dit que Pétain a sauvé des juifs !" Mais ils ne se demandent nullement si c'est vrai, la question même serait criminelle. Faute des connaissances suffisantes, je ne saurais le démentir ni l'approuver, mais Gil Mihaely a eu la bonne idée de demander à Stéphane Amar, notre correspondant en Israël, d'interviewer Alain Michel, le rabbin-historien dont Zemmour reprend les thèses. […] Ses propos, qui vont à l'encontre de certitudes inculquées depuis l'adolescence, ne laissent pas de troubler. Mais n'est-ce pas le propre de toute pensée stimulante ? Rappelons ce qu'écrit Raymond Aron en 1979, dans un article intitulé "Les Juifs, Vichy et Israël", où il critique un livre d'Alfred Fabre-Luce : "Fabre-Luce cite une phrase d'un historien non suspect d'antisémitisme, Léon Poliakov : 'Du sort relativement plus clément des juifs de France, Vichy fut en fait le facteur prépondérant.' On peut discuter l'adjectif prépondérant, pas réfuter les chiffres." Peut-être Raymond Aron se trompe-t-il, mais nos belles âmes résistantes d'aujourd'hui auraient-elles le front de l'accuser d'antisémitisme et de pétainisme ? On ne suivra pas Zemmour, même dans son questionnement, quand il fait de Pétain, signataire du statut des Juifs, un chantre de l'assimilation. Mais pousser le bouchon trop loin ne fait pas de lui un criminel contre l'humanité. Et s'il ébranle nos certitudes, c'est peut-être qu'elles sont fautives. »
« On ne saurait cependant passer sous silence le malaise que provoque le cas Zemmour chez nombre de juifs de France qui ne sont plus vraiment des israélites selon son cœur, ce qui ne les empêche pas d'être pleinement français. […] Si beaucoup partagent son inquiétude, et c'est un faible mot, face à l'islamisation qui en a tué certains et fait partir d'autres, en Israël ou vers des zones moins hostiles que leur banlieue, ils n'ont pas envie de voir ressurgir le soupçon de double allégeance ni de renoncer à l'attachement que beaucoup éprouvent pour Israël, refuge éventuel où la plupart n'iront jamais s'installer. Eh bien, dira-t-on, n'est-ce pas la définition même de la double-allégeance ? Sauf que, d'une part, le souci d'Israël n'emporte nullement la haine de la France et que, d'autre part, l'amour de sa patrie doit, comme celui d'un être cher, souffrir l'ambiguïté et même une certaine dose de contradiction. Or, habité par une conception quasi mathématique de la nation et de l'histoire, Zemmour refuse cette zone grise où les choses ne se démontrent pas mais se ressentent. Ce qui explique son incapacité à prendre en compte les tourments des identités minoritaires (et cela s'applique à nombre de juifs aussi bien qu'à beaucoup de musulmans) comme une partie intégrante de la réalité. Cela ne signifie pas que l'on doive accepter toutes les réclamations qui en découlent, mais qu'il faut les comprendre. »
C'est, à notre connaissance, la seule biographie de l'amiral Auphan. L'auteur, Jean Laplane, rerace son parcours de sa naissance jusqu'au début de la Seconde guerre mondiale. Alors que son lvire venait de paraître, en 2018, il avait accordé un entretien au Journal de l'économie.
« Le premier élément qui me semble important est son commandement de la Jeanne d'Arc, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui a permis de former toute une génération d'officiers. »
« Le second est sa participation au gouvernement de Vichy. Protégé de Darlan, il occupa le poste de chef de la marine marchande, rôle très important pour une France occupée qui compte beaucoup sur ses possessions d'outre-mer pour maintenir son importance géopolitique. Il a été également commandant en chef des Forces navales françaises, puis, après le départ du gouvernement de Darlan, secrétaire d'État à la Marine. Il quitta ce poste peu de temps avant le sabordage de la Flotte à Toulon, en raison de son désaccord avec la politique de Laval. »
« Enfin le troisième élément est la vision qu'il a développée de la Marine et de l'Histoire dans plusieurs livres, dont certains en collaboration avec Jacques Mordal (pseudonyme de Hervé Cras). Ces livres magnifient le rôle de la Marine et ont marqué les officiers de marine après la guerre, en proposant la vision d'une flotte qui a accompli son devoir tout au long des tribulations traversées durant cette période. »
« Le parcours de Paul Auphan est un mélange d'éléments classiques et originaux. […] Pour les points plus originaux, il faut commencer par se pencher sur le début de la carrière d'Auphan, durant la Première Guerre où ce jeune officier passe des sous-marins, arme qui acquiert sa réputation durant ce conflit, au renseignement. À l'époque des cuirassés, ces deux affectations distinguent déjà sensiblement le parcours d'Auphan, notamment l'expérience sous-marine qu'il abordera de nouveau lors de son passage en cabinet ministériel. »
« Autre point intéressant, celui de ses relations en politique. Lors de ses passages en cabinet et tout au long de sa carrière, Auphan va croiser la route de grands hommes de l'époque, comme Georges Leygues, grand artisan de la reconstitution de la flotte durant l'entre-deux-guerres, qui a influencé son parcours. On peut cependant estimer que la plus importante collaboration qu'il fera sera celle avec le futur amiral Darlan, dont il fera partie des protégés. »
« Enfin, un dernier point : Auphan n'a jamais eu de grand commandement avant son accession à l'amiralat. Il a commandé des bâtiments prestigieux comme l'Émile Bertin, des contre-torpilleurs récents et rapides type Guépard, ou enfin la Jeanne d'Arc, mais aucun commandement stratégique, comme une escadre. Il n'a commandé que des bâtiments isolés, jamais plus importants que des croiseurs. Car la carrière d'Auphan s'est développée de manière atypique, compte tenu des qualités professionnelles, personnelles et relationnelles dont il fit preuve lors de ses différents postes. »
« En plus d'une carrière rapide, brillante et menée en passant par des voies originales, on peut retenir que Paul Auphan reste le reflet de la marine de son époque, celle qui voulut se renouveler en se fondant sur certains principes stratégiques qui auront leurs limites plus tard : une marine technologiquement avancée, avec des bâtiments technologiquement puissants, rapides, adaptés aux missions de l'empire français et à la protection méditerranéenne. Mais une marine qui a manqué certaines innovations comme le sonar et l'émergence des porte-avions. Auphan a par exemple collaboré sur le sujet de l'aéronavale, souhaitant la voir se développer, mais sans envisager les possibilités que d'autres puissances navales avaient étudiées. »
« Il incarne également un archétype : celui de l'officier catholique dont la morale et la conception du monde maritime et des rapports que la Marine noue avec le pays. »
« Le premier élément qui me semble important est son commandement de la Jeanne d'Arc, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui a permis de former toute une génération d'officiers. »
« Le second est sa participation au gouvernement de Vichy. Protégé de Darlan, il occupa le poste de chef de la marine marchande, rôle très important pour une France occupée qui compte beaucoup sur ses possessions d'outre-mer pour maintenir son importance géopolitique. Il a été également commandant en chef des Forces navales françaises, puis, après le départ du gouvernement de Darlan, secrétaire d'État à la Marine. Il quitta ce poste peu de temps avant le sabordage de la Flotte à Toulon, en raison de son désaccord avec la politique de Laval. »
« Enfin le troisième élément est la vision qu'il a développée de la Marine et de l'Histoire dans plusieurs livres, dont certains en collaboration avec Jacques Mordal (pseudonyme de Hervé Cras). Ces livres magnifient le rôle de la Marine et ont marqué les officiers de marine après la guerre, en proposant la vision d'une flotte qui a accompli son devoir tout au long des tribulations traversées durant cette période. »
« Le parcours de Paul Auphan est un mélange d'éléments classiques et originaux. […] Pour les points plus originaux, il faut commencer par se pencher sur le début de la carrière d'Auphan, durant la Première Guerre où ce jeune officier passe des sous-marins, arme qui acquiert sa réputation durant ce conflit, au renseignement. À l'époque des cuirassés, ces deux affectations distinguent déjà sensiblement le parcours d'Auphan, notamment l'expérience sous-marine qu'il abordera de nouveau lors de son passage en cabinet ministériel. »
« Autre point intéressant, celui de ses relations en politique. Lors de ses passages en cabinet et tout au long de sa carrière, Auphan va croiser la route de grands hommes de l'époque, comme Georges Leygues, grand artisan de la reconstitution de la flotte durant l'entre-deux-guerres, qui a influencé son parcours. On peut cependant estimer que la plus importante collaboration qu'il fera sera celle avec le futur amiral Darlan, dont il fera partie des protégés. »
« Enfin, un dernier point : Auphan n'a jamais eu de grand commandement avant son accession à l'amiralat. Il a commandé des bâtiments prestigieux comme l'Émile Bertin, des contre-torpilleurs récents et rapides type Guépard, ou enfin la Jeanne d'Arc, mais aucun commandement stratégique, comme une escadre. Il n'a commandé que des bâtiments isolés, jamais plus importants que des croiseurs. Car la carrière d'Auphan s'est développée de manière atypique, compte tenu des qualités professionnelles, personnelles et relationnelles dont il fit preuve lors de ses différents postes. »
« En plus d'une carrière rapide, brillante et menée en passant par des voies originales, on peut retenir que Paul Auphan reste le reflet de la marine de son époque, celle qui voulut se renouveler en se fondant sur certains principes stratégiques qui auront leurs limites plus tard : une marine technologiquement avancée, avec des bâtiments technologiquement puissants, rapides, adaptés aux missions de l'empire français et à la protection méditerranéenne. Mais une marine qui a manqué certaines innovations comme le sonar et l'émergence des porte-avions. Auphan a par exemple collaboré sur le sujet de l'aéronavale, souhaitant la voir se développer, mais sans envisager les possibilités que d'autres puissances navales avaient étudiées. »
« Il incarne également un archétype : celui de l'officier catholique dont la morale et la conception du monde maritime et des rapports que la Marine noue avec le pays. »
« Pour le chef d'état-major de la Marine nationale (CEMM), l'amiral Pierre Vandier, il ne "faut pas se tromper de cible" dans cette affaire. C'est en effet ce qu'il a déclaré lors d'une audition à l'Assemblée nationale. »
« "Je vous invite à relire le discours du général de Gaulle, prononcé au lendemain de l'attaque de Mers-el-Kébir", a en effet dit le CEMM aux députés, qui l'interrogeaient sur l'alliance AUKUS, en faisant référence à "l'affreuse canonnade d'Oran", au cours de laquelle la Royal Navy mit hors de combat l'escadre française qui y était basée, le 3 juillet 1940. »
« "En dépit du caractère funeste de cet épisode, au cours duquel près de 1 300 marins français ont été tués alors qu'ils tentaient de contrer l'assaut des Britanniques, le général avait appelé à ne pas se tromper de cible : l'Allemagne demeurait le véritable ennemi de la France. Il convient d'aborder l'AUKUS avec la même prudence", a poursuivi l'amiral Vandier. »
« S'il a estimé que cette affaire était "inacceptable entre alliés", "tant sur le fond que sur la forme", celui-ci a fait valoir qu'elle était néanmoins un "très bon indicateur de la perception de l'accroissement des tensions par de nombreux pays dans la zone indo-pacifique". »
« "Je vous invite à relire le discours du général de Gaulle, prononcé au lendemain de l'attaque de Mers-el-Kébir", a en effet dit le CEMM aux députés, qui l'interrogeaient sur l'alliance AUKUS, en faisant référence à "l'affreuse canonnade d'Oran", au cours de laquelle la Royal Navy mit hors de combat l'escadre française qui y était basée, le 3 juillet 1940. »
« "En dépit du caractère funeste de cet épisode, au cours duquel près de 1 300 marins français ont été tués alors qu'ils tentaient de contrer l'assaut des Britanniques, le général avait appelé à ne pas se tromper de cible : l'Allemagne demeurait le véritable ennemi de la France. Il convient d'aborder l'AUKUS avec la même prudence", a poursuivi l'amiral Vandier. »
« S'il a estimé que cette affaire était "inacceptable entre alliés", "tant sur le fond que sur la forme", celui-ci a fait valoir qu'elle était néanmoins un "très bon indicateur de la perception de l'accroissement des tensions par de nombreux pays dans la zone indo-pacifique". »
« Il faut dépasser le sourire : l'enjeu est vital. Le 14 mai dernier, une équipe de scientifiques japonais a publié une étude dont on ne doit pas sous-estimer l'importance. […] Cherchant des alternatives à l'intubation dans les cas de détresse respiratoire, l'équipe s'est ingéniée à mettre à profit la vascularisation des intestins : les échanges entre la paroi intestinale et le système sanguin sont importants et rapides. L'idée de ces chercheurs était donc d'utiliser ce point d'entrée pour tenter de faire passer l'oxygène dans le sang. […] L'expérimentation sur des cochons démontra alors la possibilité d'une "respiration" intestinale, sans conséquence néfaste. »
« Il s'agit maintenant de voir dans quelles conditions et avec quel succès la technique peut être employée sur des êtres humains – et espérer que l'impact qu'elle aura, dans le monde médical et dans les médias, dépassera effectivement l'anecdote d'actualité et le sourire. L'histoire des sciences montre que le lien entre idée, efficacité et adoption d'une pratique est bien plus complexe qu'on pourrait le croire. Et le cas de la réanimation "inversée" est à ce titre exceptionnel. »
« En effet, ces chercheurs japonais ont renoué sans le savoir avec une tradition médicale européenne méconnue, qui proposait de ramener à la vie des asphyxiés en soufflant dans le derrière dès la fin du XVe siècle. Cette pratique, rarement mentionnée, ne prit une réelle importance qu'au XVIIIe siècle, lorsque la réanimation des noyés devint un véritable enjeu pour les Lumières – jusque-là, on ne pensait guère à réanimer. Les savants innovèrent en changeant l'injection d'air par l'injection de fumée de tabac : l'idée n'était pas d'injecter de l'oxygène, celui-ci, et la chimie de la respiration, ne furent découverts que dans les années 1770. Sous cette forme tabagique, l'insufflation anale fut jusqu'au milieu du XIXe siècle la pratique phare de la réanimation médicale, avant de disparaître, sans réelle explication. »
« Il serait assez tentant de voir là un récit en pointillé sur des siècles et à l'échelle mondiale : une vieille intuition médicale de la fin du Moyen Âge, développée enfin au siècle des Lumières, perdue, puis retrouvée au temps du coronavirus par des Japonais. C'est une narration possible, mais ce n'est ni la plus probable, ni surtout la plus intéressante : il faut choisir les questions que l'on pose à l'histoire. Si l'on ne cherche pas à lui faire dire que la vérité et l'efficacité scientifiques apparaissent progressivement, surmontant les obstacles que les époques leur tendent (une vision biaisée et linéaire qu'on appelle téléologique), on voit apparaître des chemins méandreux, des motifs et des interactions inattendus entre la culture et la science. »
« Toujours est-il que la pratique connut un succès incroyable : lorsque, à la fin des années 1760, les sociétés de secours aux noyés commencent à se répandre en Europe, l'insufflation anale est toujours la première technique recommandée. Comme les défibrillateurs publics de nos jours, on vit alors, à Amsterdam, Paris, Londres, Berne, Venise et dans des centaines d'autres villes, apparaître des "boîtes fumigatoires". Il s'agissait de caisses contenant le nécessaire à réanimation, c'est-à-dire, avant tout, un soufflet adapté à un brûleur de tabac. À Paris, Amsterdam et Londres, ces sociétés, plus ou moins soutenues par le pouvoir, recensèrent scrupuleusement leurs activités : noyés repêchés, techniques mises en œuvre, succès… à en croire ces documents, les cas prouvant l'efficacité de l'insufflation anale se mesurent en centaines. On ne saurait les prendre pour argent comptant cependant. […] Les cas de "réussite" peuvent correspondre à de simples réveils, dus à la douleur provoquée par l'insufflation anale. Si l'on ne peut pas apporter de réponse certaine à la question de l'efficacité ou de l'inefficacité de cette étrange pratique, les indices tendent plus vers une efficacité très modérée ou nulle. »
« Quoi qu'il en soit, et quelles que soient ses sources d'inspiration, l'équipe japonaise aboutit bien à un résultat très prometteur. Celui-ci pose une question vertigineuse. La respiration intestinale des loches n'est pas une découverte. Le perfluorocarbone non plus – on trouve dès les années 1960 des études sur la capacité de mammifères à respirer ce liquide par les poumons, un motif mis en scène dans le film Abyss (1989). Quant à la connaissance de la capacité d'absorption du rectum, cela est vieux comme les suppositoires. La question est : pourquoi ces éléments simples, parfaitement connus, n'ont pas été rassemblés plus tôt, qui plus est quand l'enjeu est celui d'une alternative à l'intubation dont les risques sont tout autant connus ? Dire ceci ne retire rien au mérite de l'étude japonaise, au contraire. Mais sur le temps long, ce sera peut-être moins cette étude qui paraîtra étonnante que sa genèse tardive. »
« Il s'agit maintenant de voir dans quelles conditions et avec quel succès la technique peut être employée sur des êtres humains – et espérer que l'impact qu'elle aura, dans le monde médical et dans les médias, dépassera effectivement l'anecdote d'actualité et le sourire. L'histoire des sciences montre que le lien entre idée, efficacité et adoption d'une pratique est bien plus complexe qu'on pourrait le croire. Et le cas de la réanimation "inversée" est à ce titre exceptionnel. »
« En effet, ces chercheurs japonais ont renoué sans le savoir avec une tradition médicale européenne méconnue, qui proposait de ramener à la vie des asphyxiés en soufflant dans le derrière dès la fin du XVe siècle. Cette pratique, rarement mentionnée, ne prit une réelle importance qu'au XVIIIe siècle, lorsque la réanimation des noyés devint un véritable enjeu pour les Lumières – jusque-là, on ne pensait guère à réanimer. Les savants innovèrent en changeant l'injection d'air par l'injection de fumée de tabac : l'idée n'était pas d'injecter de l'oxygène, celui-ci, et la chimie de la respiration, ne furent découverts que dans les années 1770. Sous cette forme tabagique, l'insufflation anale fut jusqu'au milieu du XIXe siècle la pratique phare de la réanimation médicale, avant de disparaître, sans réelle explication. »
« Il serait assez tentant de voir là un récit en pointillé sur des siècles et à l'échelle mondiale : une vieille intuition médicale de la fin du Moyen Âge, développée enfin au siècle des Lumières, perdue, puis retrouvée au temps du coronavirus par des Japonais. C'est une narration possible, mais ce n'est ni la plus probable, ni surtout la plus intéressante : il faut choisir les questions que l'on pose à l'histoire. Si l'on ne cherche pas à lui faire dire que la vérité et l'efficacité scientifiques apparaissent progressivement, surmontant les obstacles que les époques leur tendent (une vision biaisée et linéaire qu'on appelle téléologique), on voit apparaître des chemins méandreux, des motifs et des interactions inattendus entre la culture et la science. »
« Toujours est-il que la pratique connut un succès incroyable : lorsque, à la fin des années 1760, les sociétés de secours aux noyés commencent à se répandre en Europe, l'insufflation anale est toujours la première technique recommandée. Comme les défibrillateurs publics de nos jours, on vit alors, à Amsterdam, Paris, Londres, Berne, Venise et dans des centaines d'autres villes, apparaître des "boîtes fumigatoires". Il s'agissait de caisses contenant le nécessaire à réanimation, c'est-à-dire, avant tout, un soufflet adapté à un brûleur de tabac. À Paris, Amsterdam et Londres, ces sociétés, plus ou moins soutenues par le pouvoir, recensèrent scrupuleusement leurs activités : noyés repêchés, techniques mises en œuvre, succès… à en croire ces documents, les cas prouvant l'efficacité de l'insufflation anale se mesurent en centaines. On ne saurait les prendre pour argent comptant cependant. […] Les cas de "réussite" peuvent correspondre à de simples réveils, dus à la douleur provoquée par l'insufflation anale. Si l'on ne peut pas apporter de réponse certaine à la question de l'efficacité ou de l'inefficacité de cette étrange pratique, les indices tendent plus vers une efficacité très modérée ou nulle. »
« Quoi qu'il en soit, et quelles que soient ses sources d'inspiration, l'équipe japonaise aboutit bien à un résultat très prometteur. Celui-ci pose une question vertigineuse. La respiration intestinale des loches n'est pas une découverte. Le perfluorocarbone non plus – on trouve dès les années 1960 des études sur la capacité de mammifères à respirer ce liquide par les poumons, un motif mis en scène dans le film Abyss (1989). Quant à la connaissance de la capacité d'absorption du rectum, cela est vieux comme les suppositoires. La question est : pourquoi ces éléments simples, parfaitement connus, n'ont pas été rassemblés plus tôt, qui plus est quand l'enjeu est celui d'une alternative à l'intubation dont les risques sont tout autant connus ? Dire ceci ne retire rien au mérite de l'étude japonaise, au contraire. Mais sur le temps long, ce sera peut-être moins cette étude qui paraîtra étonnante que sa genèse tardive. »
« Le conseil académique de San Francisco a voté en faveur de la destitution de Lincoln, de sept autres présidents des États-Unis, de trois anciens maires de la ville et d'une vingtaine d'autres notables et pour que leurs noms soient retirés d'écoles publiques parce qu'il s'agissait soit de racistes, soit de conquistadors, ou parce qu'ils avaient un lien avec l'esclavage, le racisme ou l'oppression. »
« Le lycée Mission et le collège Presidio se sont également retrouvés sur la liste. Le couperet n'a même pas épargné ce qui est le nom d'un mythe : El Dorado. Quant à Alamo, mieux vaut l'oublier. Washington, Jefferson, Daniel Webster, Paul Revere, John Muir, Robert Louis Stevenson, Francis Scott Key et James Marshall, dont la découverte a déclenché la ruée vers l'or qui a transformé la Californie, tous sont désormais exclus. La sénatrice démocrate Dianne Feinstein est la seule personne vivante sur la liste. Quand elle était maire, elle avait ordonné qu'un drapeau confédéré arraché par des manifestants soit remis à sa place dans une salle de la mairie. C'était il y a trente-six ans. »
« Le lycée Mission et le collège Presidio se sont également retrouvés sur la liste. Le couperet n'a même pas épargné ce qui est le nom d'un mythe : El Dorado. Quant à Alamo, mieux vaut l'oublier. Washington, Jefferson, Daniel Webster, Paul Revere, John Muir, Robert Louis Stevenson, Francis Scott Key et James Marshall, dont la découverte a déclenché la ruée vers l'or qui a transformé la Californie, tous sont désormais exclus. La sénatrice démocrate Dianne Feinstein est la seule personne vivante sur la liste. Quand elle était maire, elle avait ordonné qu'un drapeau confédéré arraché par des manifestants soit remis à sa place dans une salle de la mairie. C'était il y a trente-six ans. »
« Pour éviter les débordements survenus en 2019 dans le centre-ville du Mans sur ce même thème, le préfet de la Sarthe, Patrick Dallennes, a décidé d'interdire toute manifestation ou tout rassemblement qui serait en lien avec la commémoration de la "bataille du Mans" de 1793. Pour rappel, en marge de ce temps d'hommage l'an passé, des violences avaient éclaté et des dégradations avaient eu lieu, secteur de la place de la Sirène, devant plusieurs bars. La préfecture indique qu'une déclaration a été déposée le 7 décembre pour commémorer le souvenir vendéen le 12 décembre place du Cardinal-Grente au Mans, de 19 heures à 21 heures, appel qui a été relayé sur le site de l'Action française. En réponse, des militants du collectif "anti-fasciste 72" veulent de leur côté organiser une contre-manifestation ce même jour place des Jacobins, précise-t-on. Par ailleurs, ce samedi toujours, une nouvelle manifestation contre le projet de loi "sécurité globale" est prévue au Mans devant la préfecture à 15 heures. »
Extraits d'une tribune signée Gilles Antonowicz, avocat, historien, François Garçon, historien, enseignant-chercheur, et Limore Yagil, historienne, professeur d'histoire contemporaine :
« N'ayons pas peur des mots : plus les jours passent, plus la police de la pensée fait des ravages. Dernier épisode en date, la comparution d'Éric Zemmour le mercredi 9 décembre devant le tribunal correctionnel. Son délit ? Avoir soutenu lors d'un débat télévisé que le maréchal Pétain aurait joué un rôle dans le (relatif) sauvetage des juifs de nationalité française. Ce faisant, il se serait rendu coupable de contestation de crime contre l'humanité. »
« On se frotte les yeux. On se pince. Car Zemmour ne fait que reprendre – de manière certes abrupte, lapidaire et caricaturale dans la forme – ce qu'ont soutenu et soutiennent encore, non sans raisons, quantités d'historiens, dont, entre autres, Léon Poliakov dans le Bréviaire de la haine (1951), Raul Hilberg, dans sa monumentale somme La Destruction des juifs d'Europe, l'académicien français Robert Aron dans son Histoire de Vichy et, plus récemment, le chercheur franco-israélien Alain Michel dans son livre Vichy et la Shoah (2014). »
« Le parquet a requis 10 000 euros d'amende. Mais quelle est la légitimité du parquet pour réclamer une telle peine ? Que connaît-il du sujet ? Les tribunaux sont manifestement incompétents, à tous les sens du terme, pour juger la complexité des débats historiques. »
« On aurait pourtant pu croire la question réglée depuis longtemps. Le 13 juillet 1984, Le Monde assura la publicité d'un texte dont Jacques Isorni, l'avocat historique de Pétain, était l'auteur. […] Plainte avait alors été déposée. […] Au mois de juin 1986, le siège du parquet était occupé par le jeune substitut Philippe Bilger qui, avec sagesse, requit la relaxe. […] Une semaine plus tard, le tribunal rendit son jugement. Tous les prévenus furent relaxés. Les associations résistantes firent appel. Considérant que le manifeste litigieux contenait "implicitement et nécessairement" l'apologie des crimes de collaboration, quand bien même y étaient évoquées les atrocités et persécutions nazies, Isorni fut condamné à verser un franc de dommages et intérêts. La Cour de cassation confirma cette décision. Isorni saisit alors la Cour européenne des droits de l'homme. Le 23 septembre 1998 – trois ans après la mort d'Isorni – les juges européens condamnèrent la France à verser 100 000 francs de dommages et intérêts à ses héritiers de manière à compenser le préjudice né de sa condamnation, jugée "disproportionnée dans une société démocratique". […] La Cour constatait qu'Isorni n’avait jamais tenu de propos négationnistes, ni voulu minimiser l'Holocauste. […] Que si les autorités nationales pouvaient sanctionner des paroles racistes ou négationnistes émises lors de tels débats, elles ne pouvaient pas purement et simplement interdire le débat. Heureux temps. Quelle régression ! »
« N'ayons pas peur des mots : plus les jours passent, plus la police de la pensée fait des ravages. Dernier épisode en date, la comparution d'Éric Zemmour le mercredi 9 décembre devant le tribunal correctionnel. Son délit ? Avoir soutenu lors d'un débat télévisé que le maréchal Pétain aurait joué un rôle dans le (relatif) sauvetage des juifs de nationalité française. Ce faisant, il se serait rendu coupable de contestation de crime contre l'humanité. »
« On se frotte les yeux. On se pince. Car Zemmour ne fait que reprendre – de manière certes abrupte, lapidaire et caricaturale dans la forme – ce qu'ont soutenu et soutiennent encore, non sans raisons, quantités d'historiens, dont, entre autres, Léon Poliakov dans le Bréviaire de la haine (1951), Raul Hilberg, dans sa monumentale somme La Destruction des juifs d'Europe, l'académicien français Robert Aron dans son Histoire de Vichy et, plus récemment, le chercheur franco-israélien Alain Michel dans son livre Vichy et la Shoah (2014). »
« Le parquet a requis 10 000 euros d'amende. Mais quelle est la légitimité du parquet pour réclamer une telle peine ? Que connaît-il du sujet ? Les tribunaux sont manifestement incompétents, à tous les sens du terme, pour juger la complexité des débats historiques. »
« On aurait pourtant pu croire la question réglée depuis longtemps. Le 13 juillet 1984, Le Monde assura la publicité d'un texte dont Jacques Isorni, l'avocat historique de Pétain, était l'auteur. […] Plainte avait alors été déposée. […] Au mois de juin 1986, le siège du parquet était occupé par le jeune substitut Philippe Bilger qui, avec sagesse, requit la relaxe. […] Une semaine plus tard, le tribunal rendit son jugement. Tous les prévenus furent relaxés. Les associations résistantes firent appel. Considérant que le manifeste litigieux contenait "implicitement et nécessairement" l'apologie des crimes de collaboration, quand bien même y étaient évoquées les atrocités et persécutions nazies, Isorni fut condamné à verser un franc de dommages et intérêts. La Cour de cassation confirma cette décision. Isorni saisit alors la Cour européenne des droits de l'homme. Le 23 septembre 1998 – trois ans après la mort d'Isorni – les juges européens condamnèrent la France à verser 100 000 francs de dommages et intérêts à ses héritiers de manière à compenser le préjudice né de sa condamnation, jugée "disproportionnée dans une société démocratique". […] La Cour constatait qu'Isorni n’avait jamais tenu de propos négationnistes, ni voulu minimiser l'Holocauste. […] Que si les autorités nationales pouvaient sanctionner des paroles racistes ou négationnistes émises lors de tels débats, elles ne pouvaient pas purement et simplement interdire le débat. Heureux temps. Quelle régression ! »
Pourquoi François Mitterand a-t-il accepté la privatisation de Renault ? « Je ne suis pas loin de penser que cela répond à un vieux souvenir pétainiste », répond Benjamin Cuq ; « que cela lui a permis de défaire ce que Charles de Gaulle a fait ». Donte acte. Tout l'entretien est du même tonneau. Si la critique de Carlos Ghosn est légitime, celle -ci semble peu crédible.
Une publicité exhumée par Olivier Dauvers. Comment on n'en verra plus ces jours-ci, effectivement.
« La collection Prestige des éditions ETAI publie un superbe ouvrage écrit par Christian Rouxel, consacré à l'entreprise pionnière du raffinage et de la distribution de pétrole en France, Fenaille et Despeaux, qui deviendra plus tard la célèbre Esso. »
« Au-delà de l'histoire familiale et de celle de cette entreprise, l'ouvrage nous replonge pleinement dans les débuts de l'ère du pétrole. Source de méfiance initialement dans nos contrées en raison d'une tenace réputation de "dangerosité" mais aussi de préjugés politiques (le pétrole "lampant" servi lors de la Commune à déclencher les incendies lors de la semaine sanglante), le pétrole s'impose peu à peu en raison de sa praticité, de son rendement, de son prix attractif et de la qualité des produits raffinés en France. »
« La France se caractérise longtemps par une résistance aux Américains, qui n'arrivent pas, malgré la puissance de frappe du trust de Rockfeller, à pénétrer et dominer le marché de produits raffinés jalousement gardé par des compagnies françaises. Le raffinage à la française est protégé par une politique fiscale avantageuse, une protection étatique et le choix du "premium". Mais l'État commence à y mettre son grain de sel, à la fois pour y ponctionner une manne financière juteuse mais aussi essayer d'en prendre le contrôle. La question du monopole d'État est un véritable serpent de mer qui suscite des débats passionnés tout au long de ces années, avec des arguments qui font écho à notre époque sur les profits éhontés des compagnies pétrolières. »
« C'est la guerre de 14-18 qui change radicalement la donne. Avec des besoins en pétrole croissants pour répondre à la mécanisation de la guerre moderne, l'État français profite du contexte de mobilisation pour prendre en main la filière du pétrole et surtout les approvisionnements venant essentiellement des États-Unis, faisant perdre ainsi aux compagnies privées une grande partie de leurs prérogatives. L'État […] maintient après la guerre un contrôle étatique rigoureux, tout en essayant, à la faveur des traités, d'obtenir sa "part du gâteau" notamment en Irak. Toutefois, l'après-guerre finit par marquer le triomphe des majors anglo-saxonnes, qui tirent profit de la libéralisation progressive du secteur et de leur capacité à casser les prix pour prendre d'assaut le marché français et fragiliser les indépendants. »
« Le livre est d'une grande richesse. Le récit, très détaillé, abondamment sourcé et soucieux de replacer l'histoire de cette entreprise dans le contexte national et international, s'accompagne d'une abondante iconographie et documentation »
« Au-delà de l'histoire familiale et de celle de cette entreprise, l'ouvrage nous replonge pleinement dans les débuts de l'ère du pétrole. Source de méfiance initialement dans nos contrées en raison d'une tenace réputation de "dangerosité" mais aussi de préjugés politiques (le pétrole "lampant" servi lors de la Commune à déclencher les incendies lors de la semaine sanglante), le pétrole s'impose peu à peu en raison de sa praticité, de son rendement, de son prix attractif et de la qualité des produits raffinés en France. »
« La France se caractérise longtemps par une résistance aux Américains, qui n'arrivent pas, malgré la puissance de frappe du trust de Rockfeller, à pénétrer et dominer le marché de produits raffinés jalousement gardé par des compagnies françaises. Le raffinage à la française est protégé par une politique fiscale avantageuse, une protection étatique et le choix du "premium". Mais l'État commence à y mettre son grain de sel, à la fois pour y ponctionner une manne financière juteuse mais aussi essayer d'en prendre le contrôle. La question du monopole d'État est un véritable serpent de mer qui suscite des débats passionnés tout au long de ces années, avec des arguments qui font écho à notre époque sur les profits éhontés des compagnies pétrolières. »
« C'est la guerre de 14-18 qui change radicalement la donne. Avec des besoins en pétrole croissants pour répondre à la mécanisation de la guerre moderne, l'État français profite du contexte de mobilisation pour prendre en main la filière du pétrole et surtout les approvisionnements venant essentiellement des États-Unis, faisant perdre ainsi aux compagnies privées une grande partie de leurs prérogatives. L'État […] maintient après la guerre un contrôle étatique rigoureux, tout en essayant, à la faveur des traités, d'obtenir sa "part du gâteau" notamment en Irak. Toutefois, l'après-guerre finit par marquer le triomphe des majors anglo-saxonnes, qui tirent profit de la libéralisation progressive du secteur et de leur capacité à casser les prix pour prendre d'assaut le marché français et fragiliser les indépendants. »
« Le livre est d'une grande richesse. Le récit, très détaillé, abondamment sourcé et soucieux de replacer l'histoire de cette entreprise dans le contexte national et international, s'accompagne d'une abondante iconographie et documentation »
« On ne peut en vouloir aux Français d'aujourd'hui des crimes de saint Louis, de Bugeaud, ou de Laval. Ni des crimes du commerce triangulaire, ni de ceux de la colonisation ni de ceux de la collaboration avec les Nazis. Ni même condamner ceux qui, dans le passé, ont commis légalement des actes qui seraient aujourd'hui considérés, légalement ou moralement, comme des crimes : on ne peut en vouloir à Colbert, ou à Jules Ferry, d'avoir agi conformément à la loi et à la morale de leur temps ; sinon, il faudrait aussi considérer comme des meurtriers tous les présidents de la République française, jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing inclus, qui ont envoyé à l'échafaud des condamnés, en refusant d'exercer leur droit de grâce. »
« Par contre, on doit exiger de nos contemporains de faire disparaître les traces de tous ceux qui ont agi en violation des lois ou de la morale de leur temps. Par exemple, il ne devrait pas y avoir une avenue Bugeaud à Paris ; ni de rue Brasillach, ni d'avenue Céline à moins de remettre ces auteurs dans un contexte explicatif, distinguant l'homme, ignoble, de l'œuvre littéraire, très partiellement grandiose. »
« Enfin, après la dictature des racistes, il ne faut pas tomber dans une autre ségrégation qui, au nom de l'antiracisme, ne ferait qu'exacerber des différences imaginaires à l'intérieur de la seule race qui soit : la race humaine. »
« Par contre, on doit exiger de nos contemporains de faire disparaître les traces de tous ceux qui ont agi en violation des lois ou de la morale de leur temps. Par exemple, il ne devrait pas y avoir une avenue Bugeaud à Paris ; ni de rue Brasillach, ni d'avenue Céline à moins de remettre ces auteurs dans un contexte explicatif, distinguant l'homme, ignoble, de l'œuvre littéraire, très partiellement grandiose. »
« Enfin, après la dictature des racistes, il ne faut pas tomber dans une autre ségrégation qui, au nom de l'antiracisme, ne ferait qu'exacerber des différences imaginaires à l'intérieur de la seule race qui soit : la race humaine. »
Le site évoque des statues « destinées à célébrer ceux qui ont joué un rôle, de près ou de loin, dans la longue histoire du colonialisme et de l'esclavage ». Mais dans quels cas des monuments ont-ils été édifiés puis entretenus dans ce but ? On admire Colbert pour avoir été un grand serviteur de l'État, Jules Ferry pour avoir jeté les bases de l'École républicaine, etc. Prétendre que les statues à leur effigie étaient « destinées » à célébrer « la longue histoire du colonialisme et de l'esclavage », c'est réécrire l'histoire. Mais peut-être Daniel Schneidermann expliquera-t-il à nouveau qu'il a « factuellement tort et politiquement raison », comme il l'a dit à pour Virginie Despentes.
« Le Front populaire a-t-il désarmé le pays ? La ligne Maginot était-elle une bonne idée ? Notre armée était-elle prête ? Manquait-elle d'avions et de chars ? Les Belges sont-ils coupables ? La guerre pouvait-elle être poursuivie en Bretagne ou en Afrique du Nord ? L'appel à Pétain était-il un complot contre la République ? L'appel du 18 Juin a-t-il été entendu ? C'est à ces questions, et à quelques autres (trente au total), que répond le livre de Rémy Porte, ex-officier référent "Histoire" pour l’armée de Terre puisqu'il vient de quitter le service actif après une longue carrière de transmetteur (et de transmetteur de savoir et de culture militaire). »
« Au fil des combats et des vicissitudes du soldat au quotidien, c'est un autre visage de Gambetta qu'entrevoit André Viaud Grand Marais : le visage d'un politicien qui se veut chef militaire, alors qu'il n'a ni la formation des hommes de métier, ni le génie inné des grands conquérants ; le visage d'un obstiné de la République, qui est prêt à prendre toutes les mesures policières pour museler l'opposition ; le visage d'un arrogant, obnubilé par un Triomphe des armes qui serait un triomphe de sa personne, quitte à repousser les propositions d'armistice et à proclamer, jusqu'à la dernière minute, la guerre à outrance. »
« Il n'est pas seulement absurde, il est néfaste de s'abandonner à un danger majeur que les historiens connaissent bien. Il s'agit de l'anachronisme. Ce péché contre l'intelligence du passé consiste, à partir de nos certitudes du présent, à plaquer sur les personnages d'autrefois un jugement rétrospectif d'autant plus péremptoire qu'il est irresponsable. »
Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste, prétend que « la dernière statue de Pétain a été déboulonnée à Vichy en 2014 ». « Personne n'y a vu un geste totalitaire », a-t-il ajouté ; « Il n'a pas pour autant disparu de notre histoire ». De quoi légitimer les attaques contre Colbert ? Son tweet est ridicule. Comme le dit Frédéric Aguilera, maire de Vichy, « on nage en plein délire » ; de fait, rappelle-t-il, « il n'y a jamais eu de statue de Pétain à Vichy ». À l'origine, c'était un canular de Nordpress… jugé suffisamment crédible par Luarent Joffrin pour qu'il se laisse lui-même piéger en 2018, en signant un article publié par Historia. C'est du sérieux !
« On va aller contextualiser un film qui ne rapporte plus grand chose, qui n'est pas vraiment regardé par les nouveaux publics (sauf ces derniers jours, merci la pub), et en fait, qui ne touche pas trop à des problématiques chaud-patate. Par exemple, en France, demandez à insérer un encart avant chaque diffusion d'Autant en emporte le vent, vous pourrez vous poser en progressiste à peu de frais. Proposez la même chose avant le clip Jour de Paye de Booba, au motif qu'il y est question de mamans et de "fourrure avec les poils de ta chatte" (sic) et là, vous serez un vil conservateur parce que… et l'art alors, hein ? Quoi c'est violent ? T'as pas les codes ! Quoi ? Quel rapport entre ne pas avoir les codes et contextualiser ? Je… vite, une boule de fumée ninja ! »
« Vous l'aurez compris, contextualiser Autant en emporte le vent, en fait, ça n'a strictement aucun sens en tant que tel. Et si un gamin n'importe où dans le monde décide de prendre ce film comme base pour ses études d'histoire, il est peut-être temps de lui coller une mandale, de le coller dans une machine temporelle et de le renvoyer à l'époque où des ados demandaient à voir ce film, soit il y a environ quatre-vingts ans. »
« La réalité, c'est que nous sommes face à ce que nous ne connaissons que trop bien depuis bien trop longtemps : une formidable hypocrisie, dans laquelle le seul objectif de la petite troupe qui s'y engage est de montrer patte blanche dans un éternel effort de se réclamer d'une supériorité morale imaginaire. Contextualiser ce film, ce n'est ni plus ni moins que de la pub pour rappeler que "Eh les mecs, on vous a dit qu'on trouvait que l'esclavage, c'était pas bien ?" de la part de gens qui estiment souvent que graphiste, c'est pas vraiment un métier. »
« Vous l'aurez compris, contextualiser Autant en emporte le vent, en fait, ça n'a strictement aucun sens en tant que tel. Et si un gamin n'importe où dans le monde décide de prendre ce film comme base pour ses études d'histoire, il est peut-être temps de lui coller une mandale, de le coller dans une machine temporelle et de le renvoyer à l'époque où des ados demandaient à voir ce film, soit il y a environ quatre-vingts ans. »
« La réalité, c'est que nous sommes face à ce que nous ne connaissons que trop bien depuis bien trop longtemps : une formidable hypocrisie, dans laquelle le seul objectif de la petite troupe qui s'y engage est de montrer patte blanche dans un éternel effort de se réclamer d'une supériorité morale imaginaire. Contextualiser ce film, ce n'est ni plus ni moins que de la pub pour rappeler que "Eh les mecs, on vous a dit qu'on trouvait que l'esclavage, c'était pas bien ?" de la part de gens qui estiment souvent que graphiste, c'est pas vraiment un métier. »
« Le présent ouvrage […] nous propose une rigoureuse analyse de ces évènements, rendant notamment justice au courage et à l'abnégation des combattants français, qui ont infligé en l'espace de quarante-cinq jours de très lourdes pertes à l'ennemi, en hommes et en matériel : 170 224 hommes hors de combat, destruction de près du tiers de ses chars et de la moitié de son aviation. Il apparaît clairement que ce bilan a pesé lourd dans la suite du conflit : il a permis à l'Angleterre de récupérer la quasi-totalité de son corps expéditionnaire, de résister avec succès aux attaques aériennes allemandes, tout en empêchant Hitler de mettre la main sur l'Afrique du Nord. Notre auteur en revanche se montre sévère à l'égard des politiques et du haut commandement militaire, en particulier les généraux Gamelin, Georges, Huntziger, et même Weygand. […] Cependant, cet ouvrage passionnant, à recommander à la jeunesse, permet aussi de découvrir des grands soldats injustement oubliés comme le général Jacques Prioux, le vainqueur de Gembloux, les exploits des aviateurs français, et l'héroïsme des plus humbles, civils, religieux et militaires. »