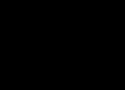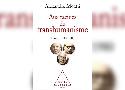4243 shaares
195 résultats
taggé
histoire
« Pourquoi parler d'une plaque minéralogique ? » À l'origine, les automobiles étaient surtout des utilitaires. « Or, ces véhicules étaient très prisés dans les mines qui prospéraient alors. […] Le secteur des mines a donc mis en place un système interne d'identification des véhicules miniers. De plus, les Mines étaient chargées de vérifier les matériels roulants des mines de charbon depuis le XVIIIe siècle, puis les chemins de fer. L'État leur a alors confié la gestion de l'identification de tous les véhicules du territoire, ainsi que la vérification de la conformité au fur et à mesure des règlements. C'est pour cela que l'on parle (parlait) de réception des Mines, ou passage aux Mines. Sur les cartes grises ou certificats d'immatriculation, il y avait même, jusque à tout récemment, le "type Mines" de précisé. C'est donc de là que vient le terme de "plaque minéralogique", du service des Mines qui les délivraient. Depuis le décret n°83-568 du 27 juin 1983, le service des Mines n'existe plus et a été remplacé par les DRIRE (Directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) puis cette dernière par les DREAL (Directions régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement). Les Ingénieurs du corps des Mines y restent très présents. »
« Le scénario assez embrouillé situe toute l’intrigue dans la capitale japonaise au sortir de la guerre dont les conséquences économiques et psychologiques sont toujours vivaces. Un tantinet mélodramatique, Tokyo Joe est surtout intéressant pour la description de la vie à Tokyo dans cette période particulière de l’occupation américaine (SCAP) avec ce qui en découle ainsi que pour la prestation efficace, mais calibrée, d’Humphrey Bogart. […] Les extérieurs, sous la forme de transparences factices, ont été captés au Japon par une seconde équipe ayant obtenu la première autorisation d’après-guerre de filmer la ville de Tokyo : à sa sortie, le film plaira au public, car les spectateurs américains le considéraient comme une sorte de documentaire. Effectivement le tableau du Japon, miné par la défaite et la présence américaine, est intéressant : Stuart Heisler a su évoquer la morosité ambiante dans laquelle se déroule cette histoire d’amour et de trafic aérien. »
« L'alphabet latin aura connu une réussite insolente et toutes les ruptures de l'histoire qui auraient pu remettre en cause son statut l'ont au contraire renforcé dans sa domination. Aujourd'hui, il est le seul alphabet répandu sur les cinq continents habités, le seul à sortir aussi aisément de sa base religieuse du catholicisme occidental, le seul dans lequel toutes les langues importantes disposent d'une transcription. Cela est certainement dû au caractère pratique du système "un son, une lettre" qui lui permet de s'adapter à toutes les langues. Ainsi Rome survit dans la mondialisation moderne. »
« Une collision avec un autre navire : telle est la raison, jamais évoquée par le ministère de la défense, pour laquelle a coulé la Minerve. Le 21 juillet 2019, après un demi-siècle d'abandon à l'obscurité, le sous-marin français a été retrouvé gisant au fond de la Méditerranée, face à Toulon. Au terme d'un demi-siècle de silence imposé par les autorités, les familles ont pu rendre hommage à leurs cinquante-deux proches, en mer. Leur fin tragique est reconstituée par l'enquête du fils du commandant du navire, Hervé Fauve, qui publie Retrouver la Minerve, ouvrage coécrit avec le journaliste Léonard Lièvre. […] Le livre répondra aux questions des passionnés d'histoire navale ; il pourra aussi intéresser les néophytes à la manière d'un roman policier. »
« On ne peut pas mener une guerre avec des gens consensuels. Le consensus, c’est Pétain. Insupportable. » Le Pr Raoult ne croyait pas si bien dire dans son entretien à Paris Match ! En effet, une francisque est discrètement apparue sur une image diffusée par la préfecture de Police. Une bourde pour le moins inattendue.
« Dans les transports en commun, les rampes et le mobilier urbain sont régulièrement désinfectés. Bernard Thomann y voit une des manifestations de l'héritage historique de l'État-nation japonais, né au XIXe siècle au contact brutal des puissances commerciales occidentales et de leurs maladies nouvelles (choléra, peste, tuberculose…). "Dès le départ, rappelle le chercheur, le gouvernement a eu le sentiment que construire un État moderne, c'était construire non seulement une défense militaire mais également une défense contre les microbes venus de l'extérieur." »
L'analyse de la situation actuelle proposée par Olivier Faure est sujette à discussion, mais ces rappels historiques sont les bienvenus :
« Sans remonter à la peste ou au choléra, il faut savoir que la grippe de Hong Kong en 1968 a par exemple fait 31 000 morts en deux mois dans une France qui ne comptait alors que 50 millions d'habitants. Aucune mesure n'avait été prise, on n'en parlait quasiment pas. Moi-même j'étais adolescent à l'époque, et je n'en ai absolument aucun souvenir. Pour la grippe espagnole, les évaluation sérieuses pour la France font état de 128 000 morts sur 40 millions d'habitants. »
« Par ailleurs, cette épidémie n'est pas surprenante par sa propagation. Même dans un monde dans lequel les déplacements n'avaient rien de commun à ceux d'aujourd'hui, la peste, en 1348, a mis seulement deux ans à ravager l'Europe ; le choléra a mis six mois à venir de Russie pour s'étendre à l'ensemble du monde. »
« Malgré la densité de la population mondiale, pour l'instant on ne voit pas d'explosion massive du Covid-19. […] Ce qui est frappant aujourd'hui, ce n'est pas l'intensité du mal, c'est l'intensité de la réaction. »
« Il est frappant de constater que notre médecine ultra-performante et technicienne puise aujourd'hui dans l'arsenal des modes de protection les plus anciens et les plus spontanés. La philosophie est la même que celle qui prévalait au Moyen Âge : les cordons sanitaires, les lazarets, les quarantaines… Sauf qu'à l'époque ces mesures ne s'appliquaient qu'aux gens suspects, ceux qui venaient de contrées dans lesquelles sévissait la maladie. Ce qu'il faut bien remarquer, c'est que jamais dans l'histoire n'a eu lieu un confinement (et un confinement des gens chez eux) à cette échelle. C'est complètement inédit. »
« Sans remonter à la peste ou au choléra, il faut savoir que la grippe de Hong Kong en 1968 a par exemple fait 31 000 morts en deux mois dans une France qui ne comptait alors que 50 millions d'habitants. Aucune mesure n'avait été prise, on n'en parlait quasiment pas. Moi-même j'étais adolescent à l'époque, et je n'en ai absolument aucun souvenir. Pour la grippe espagnole, les évaluation sérieuses pour la France font état de 128 000 morts sur 40 millions d'habitants. »
« Par ailleurs, cette épidémie n'est pas surprenante par sa propagation. Même dans un monde dans lequel les déplacements n'avaient rien de commun à ceux d'aujourd'hui, la peste, en 1348, a mis seulement deux ans à ravager l'Europe ; le choléra a mis six mois à venir de Russie pour s'étendre à l'ensemble du monde. »
« Malgré la densité de la population mondiale, pour l'instant on ne voit pas d'explosion massive du Covid-19. […] Ce qui est frappant aujourd'hui, ce n'est pas l'intensité du mal, c'est l'intensité de la réaction. »
« Il est frappant de constater que notre médecine ultra-performante et technicienne puise aujourd'hui dans l'arsenal des modes de protection les plus anciens et les plus spontanés. La philosophie est la même que celle qui prévalait au Moyen Âge : les cordons sanitaires, les lazarets, les quarantaines… Sauf qu'à l'époque ces mesures ne s'appliquaient qu'aux gens suspects, ceux qui venaient de contrées dans lesquelles sévissait la maladie. Ce qu'il faut bien remarquer, c'est que jamais dans l'histoire n'a eu lieu un confinement (et un confinement des gens chez eux) à cette échelle. C'est complètement inédit. »
« Alors que la Révolution devient une guerre civile, le rôle de la dénonciation civique se renforce encore et devient de plus en plus ambivalent. Le 5 août 1792, tout citoyen voyant une personne vêtue de signes contre-révolutionnaires est ainsi tenu "de l'arrêter ou de la dénoncer sur-le-champ, à peine d'être réputé complice". À partir du printemps 1793, les citoyens sont invités à dénoncer les "ennemis du peuple" auprès des comités de surveillance. Exclues du vote puis des assemblées politiques, les femmes y voient néanmoins une des seules manières possibles de participer à la défense de la République. Appuyées par des lois d’exception très répressives, les dénonciations deviennent alors des armes létales. »
Extrait d'un entretien avec Olivier Dard, où sont également cités le colonel Rémy et Pierre de Bénouville.
Salazar a-t-il été formé à l'école de Maurras ? La question lui a été posée. « Salazar n'esquive pas mais précise les choses : "J'ai lu les livres politiques de Maurras ; ils séduisent par la clarté, par la logique de la construction… si on en admet les prémices. Mais entre les admirateurs inconditionnels du doctrinaire français et moi, il y a une différence, disons d'attitude, qui a une influence dominante dans le champ de l'action." En réalité, Salazar ne partage pas le primat maurrassien du "politique d'abord". Salazar explique ainsi que Maurras lui a permis de rééquilibrer la place du facteur politique dans sa réflexion générale. Il admet que "la politique a sa place, remplit sa fonction", ajoutant même : "Sans elle il n'y aurait pas de Dictature et sans doute je ne serais pas ici… ".
Mais c'est pour souligner immédiatement que "la vie d'un pays est plus complexe, plus large, échappe plus aux organes et à l'action du pouvoir que beaucoup ne pourraient le croire". Salazar en réalité, tout en étant antidémocrate, refuse de considérer que l'histoire se décide uniquement par en haut : "L'histoire d'une nation n'est pas seulement l'histoire de ses conquérants, de ses grands rois ; elle est, surtout, la résultante du travail que le milieu impose aux hommes, et des qualités et défauts des hommes qui y vivent." Ces réserves effectuées, Salazar fut toute sa vie de dirigeant en contact avec les maurrassiens français qui, à l'instar d'Henri Massis, vinrent le visiter à différentes reprises et lui dire toute leur admiration pour lui et son régime. Car si Salazar a été marqué par Maurras, ce dernier l'a été tout autant, dédicaçant ainsi son recueil de poésie la Balance intérieure à celui qui "a rendu à l'autorité le visage le plus humain des visages". »
Salazar a-t-il été formé à l'école de Maurras ? La question lui a été posée. « Salazar n'esquive pas mais précise les choses : "J'ai lu les livres politiques de Maurras ; ils séduisent par la clarté, par la logique de la construction… si on en admet les prémices. Mais entre les admirateurs inconditionnels du doctrinaire français et moi, il y a une différence, disons d'attitude, qui a une influence dominante dans le champ de l'action." En réalité, Salazar ne partage pas le primat maurrassien du "politique d'abord". Salazar explique ainsi que Maurras lui a permis de rééquilibrer la place du facteur politique dans sa réflexion générale. Il admet que "la politique a sa place, remplit sa fonction", ajoutant même : "Sans elle il n'y aurait pas de Dictature et sans doute je ne serais pas ici… ".
Mais c'est pour souligner immédiatement que "la vie d'un pays est plus complexe, plus large, échappe plus aux organes et à l'action du pouvoir que beaucoup ne pourraient le croire". Salazar en réalité, tout en étant antidémocrate, refuse de considérer que l'histoire se décide uniquement par en haut : "L'histoire d'une nation n'est pas seulement l'histoire de ses conquérants, de ses grands rois ; elle est, surtout, la résultante du travail que le milieu impose aux hommes, et des qualités et défauts des hommes qui y vivent." Ces réserves effectuées, Salazar fut toute sa vie de dirigeant en contact avec les maurrassiens français qui, à l'instar d'Henri Massis, vinrent le visiter à différentes reprises et lui dire toute leur admiration pour lui et son régime. Car si Salazar a été marqué par Maurras, ce dernier l'a été tout autant, dédicaçant ainsi son recueil de poésie la Balance intérieure à celui qui "a rendu à l'autorité le visage le plus humain des visages". »
La stupeur générale découle-t-elle de la gravité de l'épidémie, ou bien de sa médiatisation à l'échelle mondiale, et surtout de la réponse qui lui est apportée en conséquence Jadis, le coronavirus se serait vraisemblablement propagé dans une indifférence quasi-générale. Y compris en France. Le précédent historique de 1968-1969 en témoigne.
« Le concept de transhumanisme n'est ni récent, ni américain : il apparaît pour la première fois en 1937 sous la plume d'un ingénieur et polytechnicien français, Jean Coutrot. Il ne traversera l'Atlantique qu'en 1951, porté par le biologiste Julian Huxley, dont le frère Aldous écrivit Le Meilleur des mondes. […] Pendant un demi-siècle, l'idée que le progrès scientifique doit faire naître une "nouvelle humanité" sera portée par de nombreux auteurs à succès, du biologiste Alexis Carrel au journaliste Louis Pauwels, créateur de la revue de science-fiction Planète en 1961, en passant par le prêtre et philosophe Pierre Teilhard de Chardin. »
Connaissez-vous Bernard London ? Il serait le « créateur » de l'obsolescence programmée, selon Mathieu Dejean. Peut-être ce journaliste, collaborateur des Inrockuptibles, a-t-il été abusé par la communication habile d'un éditeur. En tout cas, il prête à ce personnage une influence qu'il n'a jamais eue. Du moins, jusqu'à présent. Car la découverte contemporaine de son opuscule, publié en 1932 dans l'indifférence générale, se prête manifestement à une instrumentalisation idéologique efficace : cet article en témoigne, avec sa conclusion aux accents décroissantistes.
C'était le 2 septembre 1915. Le directeur de L'Action Française s'adressait en ces termes au président de la République : « Mon seul désir étant de servir le mieux possible, puisque je ne peux pas me battre, je me mets à la disposition du gouvernement français, qui peut avoir intérêt à telles ou telles suggestions utiles. » Dans ses mémoires, Raymond Poincaré raconte la suite qu'il donna à cette lettre : « J'ai répondu en proposant une audience à l'écrivain royaliste. Je l'ai remercié et lui ait dit que, si le gouvernement avait à lui donner des indications utiles pour la France, je m'empresserais de les lui faire tenir. La surdité de Charles Maurras dépasse malheureusement tout ce que je supposais. […] S'il ma mal compris et si jamais il rapporte inexactement mes paroles, je me consolerai de ses erreurs en relisant Anthinea ou les Amants de Venise. »
Incarner un juge en plein tumulte révolutionnaire ? C'est ce que propose ce jeu vidéo. « Certains procès sont joués d'avance », rapporte un critique. C'est le cas de « celui du roi Louis XVI ou citoyen Capet, au choix ». Pour lui, « la seule solution est l'échafaud » ; « autrement, c'est la fin de votre personnage ». Le ton est donné !
C'est assurément une vérité bien établie, mais peut-être le grand public n'en a-t-il pas consience : « l'objectif prioritaire du général de Gaulle était la poursuite d'opérations coup de poing, principalement pour affirmer la souveraineté de la France », rappelle Luc-Antoine Lenoir, auteur d'un livre sur les FNFL. Affirmer la souveraineté de la France… ou plus exactement celle de la « France libre ». Dans cette perspective, poursuit l'historien, « l'exemple le plus important est le ralliement de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon en décembre 1941 ».
Le souvenir de la colonisation fait polémique à Paris. En cause : une enseigne qui ornait la façade d'un bâtiment place de la Contrescarpe ; la Ville refuse de la restituer. Florence Berthout, maire du 5e arrondissement, rappelle l'avis du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage (CNMHE) : de son point de vue, il « faut utiliser ces traces du passé colonial pour l'expliquer aux générations futures » ; selon lui, « les effacer, c'est vouloir réduire au silence l'Histoire ».
« Strasbourg a été à l'origine d'un des plus beaux plantages de l'histoire diplomatique française. En effet, la France, puissance dominante de l'Europe des Six, devait accueillir sur son sol la Commission européenne et le Conseil des ministres. » Cela aurait pu se faire à Nice. Ou bien à Chantilly. « Las, un certain Pierre Pflimlin, ministre des Finances puis président du Conseil […], mais surtout maire de Strasbourg, a vu dans cette localisation une menace pour sa ville : si les institutions étaient en France, rien ne justifiait plus que l'Assemblée parlementaire soit localisée en Alsace. Les Belges ont alors gentiment proposé que Bruxelles devienne la capitale "provisoire" de la CEE. » On connaît la suite.
Le professeur Akira Nishibori est né un 14 juillet ; il y voit un signe ! Spécialiste des relations franco-japonaises, il salue plus particulièrement le rôle de l'ambassadeur Léon Roches au XIXe siècle et affirme que « la France se distingue par le fait d'avoir apporté à la fois la technologie et l'éducation ».
Michel Vovelle s'est éteint le 6 octobre 2018. Jean-Pierre Chevènement n'a pas manqué de lui rendre hommage. Paradoxalement, son discours nous semble somme toute très proche de celui tenu par des souverainistes censés récuser l'héritage de la Révolution française : « Cet héritage républicain de la Révolution française peut être subrepticement combattu par tous les tenants de la démocratie "post-moderne" et d’un "État de droit" déconnecté du suffrage universel. Il ne peut être mis en cause frontalement car il ne suffit pas de déclarer la Révolution française "terminée" pour donner congé au citoyen et au suffrage universel. Ce combat est plus actuel que jamais. »
Les sports mécaniques avaient-ils leur place de l'autre côté du Rideau de fer ? L'URSS avait certes d'autres priorités que de faire courir ses propres Formule 1. Mais il se trouve que Staline avait un fils qui en était passionné… Quelques voitures furent donc construites par des ingénieurs soviétiques qui s'appuyèrent sur des voitures récupérées en Allemagne.